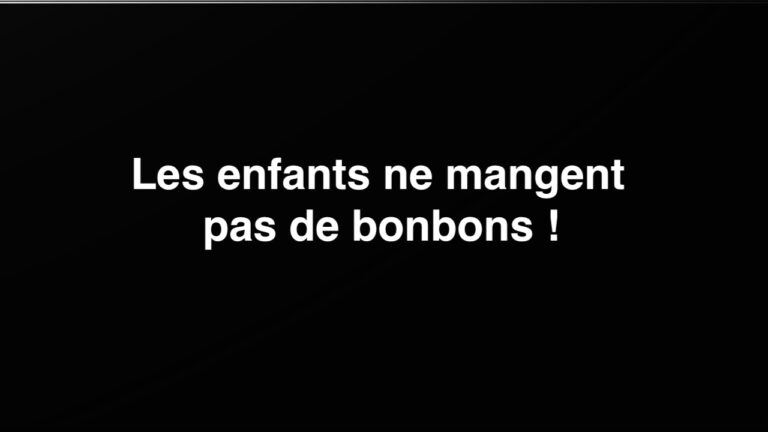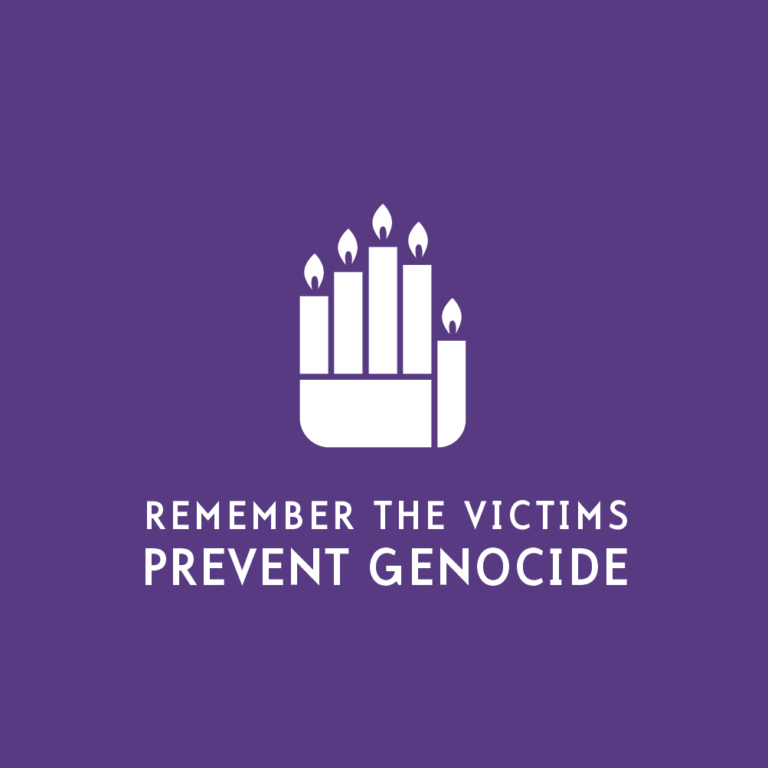L’histoire humaine est malheureusement remplie d’horreurs et de douleurs inutiles infligées à des innocents. Bien que le terme « génocide » soit une appellation moderne pour ce crime, celui-ci accompagne l’histoire humaine comme une malédiction inséparable. Et il est difficile de ne pas reconnaître que nombre d’États modernes ont bâti leurs fondations en commettant des génocides.
Sur une colline tranquille à Erevan se dresse Tsitsernakaberd, le mémorial du génocide arménien, où la pierre et la flamme perpétuent la mémoire de plus d’un million et demi de vies éteintes en 1915. Ses douze dalles solennelles encerclent une flamme éternelle, symbole à la fois du deuil et de la renaissance d’un peuple qui a refusé de disparaître. Tsitsernakaberd rappelle au monde que l’oubli invite à la répétition — une vérité que le peuple ézidi connaît trop bien. Alors que je me tenais entre ses murs silencieux, j’ai ressenti le poids de toutes les blessures non cicatrisées, les cris de ceux abandonnés à l’histoire et l’appel à les honorer non seulement par des fleurs, mais par la justice.
© Ezidi Times.
Cette année, le 3 août, marquera le onzième anniversaire du jour où les Ézidis en Irak furent ciblés par l’organisation terroriste ISIS et soumis à des actes de génocide. Bien que onze ans aient passé, de nombreux Ézidis vivent encore dans les conséquences du génocide de 2014 et ne parviennent pas à dépasser ce qu’ils ont enduré. Les raisons sont multiples. Peut-être la plus forte est-elle le fait que la communauté internationale a fait très peu pour protéger et aider les Ézidis. Beaucoup vivent dans des camps de déplacés internes, pris au piège des jeux politiques sales des Arabes, des Kurdes et des Turcs — incapables de rentrer chez eux et incapables aussi de reconstruire un avenir sûr ailleurs. Tandis que les soi-disant « autorités kurdes » prétendent aider et protéger les Ézidis vivant dans ces camps, la vérité est qu’elles ne cherchent qu’à s’assurer leurs voix. En maintenant les Ézidis sur le territoire qu’elles contrôlent, elles sécurisent les quelque 200 000 voix ézidies pour les élections. Si les Ézidis retournaient dans la zone de Sinjar contrôlée par Bagdad, ces voix seraient alors créditées aux autorités irakiennes. Toute autre prétention est réfutée par le simple fait que, sinon, ces Ézidis auraient été relogés décemment et ne vivraient pas encore sous des tentes après onze ans.
Un autre problème est que le gouvernement irakien, qui prétend être un État indépendant et souverain, a trahi ses citoyens : d’abord en ne les protégeant pas contre les groupes terroristes de l’ISIS, puis en choisissant de remplir ses poches d’argent — négligeant totalement son obligation d’allouer des ressources aux Ézidis. Si l’Irak veut survivre comme État, il doit remplir son obligation de protéger ses citoyens — tous ses citoyens — qu’ils soient Arabes, musulmans ou autres. Car si l’Irak continue à fonder son existence sur des critères discriminatoires comme il l’a fait jusqu’à présent, dans dix ou vingt ans il cessera d’exister et sera divisé entre d’autres puissances capables, elles, de protéger et de gérer l’ensemble de leurs populations.
À l’approche du onzième jour de commémoration du génocide des Ézidis en 2014, nous ne pouvons éviter d’évoquer les autres génocides qui ont été commis et la manière dont l’humanité n’a pas su tirer les leçons de ses erreurs passées. Après chaque génocide, on entend des slogans comme « N’oubliez jamais » et « Plus jamais ça », et pourtant nous nous retrouvons dans une situation désespérée où des minorités et des peuples autochtones sont massacrés par de nouvelles puissances barbares.

Le 22 novembre 2023, le président de la République d’Irak, S.E. M. Abdul Latif Jamal Rashid, a planté un arbre au mémorial de Tsitsernakaberd — un geste censé honorer la mémoire des Arméniens morts dans le génocide de 1915. Mais l’ironie est frappante : l’État qu’il représente a échoué à protéger le peuple ézidi en 2014 et continue d’échouer encore aujourd’hui. Ces gestes symboliques, aussi bien intentionnés soient-ils, servent souvent de bandeau sur les yeux des victimes et des survivants — des cérémonies qui dissimulent plutôt qu’elles ne confrontent la négligence, le déplacement et l’injustice subis par ceux qui restent. Les arbres grandiront, et les pierres des mémoriaux perdureront, mais tant que des États comme l’Irak ne prendront pas réellement la responsabilité de protéger tous leurs citoyens — Ézidis compris — ces gestes sonneront creux.
Combien de mémoriaux supplémentaires l’humanité devra-t-elle encore ériger avant d’en finir ?